Après avoir vu les toponymes liés à la ronce en langue d’oïl puis en langue d’oc, je m’intéresse aujourd’hui à leur présence dans les autres langues sur notre territoire.
L’allemand
La ronce se dit brombeer en allemand. Je n’ai trouvé, en France, que trois toponymes formés sur ce nom : Brombeeracker à Berstett (B.-Rhin), avec acker, « champ », Brombeerbaum à Gosselming (Mos.), avec baum, « arbre » (d’où sans doute le sens de mûrier) et Brombeerental à Lampertheim (B.-Rhin), la « vallée des ronces ».
De l’indo-européen ster, « aigu », est venu l’anglais thorn et l’allemand dorn, « épine », qui a pu désigner la « ronce », d’où sont issus les noms de Dornenwaedel, « petit bois de ronces, petite ronceraie » (Gries, B.-Rhin), de Dornenwiese, « prairie aux ronces » (Harn-sous-Varsberg, Mos.), de Dornheck, « la queue des ronces » (Ébersviller, id. ; Niederhaslach, B.-Rhin etc.), du ruisseau Dornengraben (graben, « fossé » – à Kaltenhouse, id.) etc.
Le basque
La langue basque connait l’arroumègue (dérivé de l’occitan roumègue, cf. le billet précédent), qui explique les noms d’Arrouméga (Buzy et Saint-Vincent, P.-A.), de L’Arroumégas (Aubiet, Gers) et des Arroumégats (Lescar, P.-A.), tous formés avec le suffixe augmentatif –as, parfois péjoratif, d’où le sens de « grandes, mauvaises ronces ». On trouve également le nom de Darre la Roume (Gan, P.-A.), « derrière la ronce », avec mécoupure de l’article et francisation.
La ronce se dit plus particulièrement sègo ou sègue, sans doute par analogie de forme et d’image entre une haie de ronces et une scie, sègue en béarnais. On trouve ainsi de nombreux noms du type Sègue (Salies-du-Béarn, P.-A. etc.) ou Sègues (Lucq-de-Béarn, id. etc.), le diminutif Les Séguettes (Tieste-Uragnou, Gers), et même une Male-Sègue (« mauvaise ronce », à Carresse, P.-A. – qui porte drôlement son nom).
Sur la racine basque lak-, « rugueux », a été formé le nom laharr désignant lui aussi la ronce, que l’on retrouve dans les noms de Laharraga (Ahetze, Istruits et Estérençuby, P.-A.), Laharrague (Lahonce, id.) et Laharraquia (Lecumberry, id.).
Le breton
Le mot breton pour la ronce est drez, collectif drezenn (à rapprocher de l’irlandais dris, de même sens). On retrouve ce terme dans quelques noms de lieux-dits comme Toul an Drez, « trou à ronces » (Douarnenez, Fin.) et Loj an Drez, « loge, abri à ronces » (Melgven, id.). En Basse-Bretagne, la ronceraie se retrouve dans des noms comme Drézit Vihan , « petite ronceraie » (Bourbriac, C.-d’A., ), Coat an Drézec, « bois des ronces » (Melgven, Fin.), le Moulin Drézec (Plourin-lès-Morlaix, id.) etc. En Haute-Bretagne se retrouvent des variantes comme Drezeux (Guérande, L.-A.) ou le Drézeul (Saint-Dolay, Mor.) – qui sont d’anciens Drezeuc.
Il est impossible de passer à côté de l’île de Drenec (Enez Drenneg), « l’île aux épines ; épinaie », de l’archipel des Glénans, et des Îles Drenec du golfe du Morbihan (Dictionnaire étymologique des îles françaises, éditions Désiris, 2023, par votre serviteur – disponible dans toutes les librairies). Sur ce même étymon ont été formés les noms de Le Drennec (An Drenneg, Fin., qui était Spinetum en 1291) et de plusieurs lieux-dits homonymes du Finistère et du Morbihan.

Le corse
La langue corse utilise le terme lama pour désigner la ronce, et le collectif lamaghja pour la ronceraie. On trouve ainsi le nom Lama d’une commune (H.-C.) et de plusieurs lieux-dits (à Levie, Forciolo, Zoza … en C.-du-Sud etc.), ainsi que Lama Vecchia (« vieille », à Poggio-Di-Nazza, C.-du-Sud), Lama Di Frati (« des moines », à Figari, H.-C.), Lama di Frassu (« du frêne », à Sotta, id.). Quelques noms sont issus du collectif, comme Lamaja (Carbini, Petreto-Bicchisano, C.-du-Sud etc.).
Le norrois
Le vieux norrois thorn, « épine » d’où « ronces » (cf. plus haut l’allemand dorn), se retrouve dans le nom Tournetuit, formé avec le vieux norrois thveit, « défrichement », d’où le sens d’« essart des ronces », de deux lieux-dits aujourd’hui disparus, l’un en forêt de Brotonne ( Mare de Tournetui en 1463, Caudebec-en-Caux, S.-Mar.) et l’autre à Grainville-la-Teinturière (id.). On retrouve encore aujourd’hui cette formation dans le nom des lieux-dits Tontuit à Saint-Benoît-d’Hébertot et à Quetteville (Calv.).
On trouve ce même thorn dans les noms de Tournebu (Calvados), avec bû, « ferme », de l’ancienne Tournedos-sur-Seine (aujourd’hui dans Porte-de-Seine, Eure), qui était Tournetot en 1631, avec topt, « ferme », ainsi que dans le déterminant de Saint-Germain-de-Tournebut (Manche) qui était Tornebusc en 1080, de thorn et buskr, « bois ». Plusieurs lieux-dits portent des noms similaires comme Tournebu (Fresney-le-Puceux, Calv.), Tournebut (Appeville, Manche ; Aubevoye, Eure) ou Tournetot (Saint-Martin-aux-Bruneaux, S.-Mar.).

La devinette
Il vous faudra trouver une commune de France métropolitaine dont le nom, en un seul mot, est lié, selon l’étymologie la plus consensuelle, à un des mots désignant la ronce étudiés dans le billet du jour, associé à un mot désignant un animal qui, mal compris, a fini par être remplacé par un mot désignant un minéral.
Le nom du chef-lieu de canton désignait une étendue unie, à vocation rurale. Il est aujourd’hui complété par le nom de la rivière qui l’arrose. Sa gare a servi à un humoriste.
Les indices :
■ pour la commune elle-même, mais pas seulement :
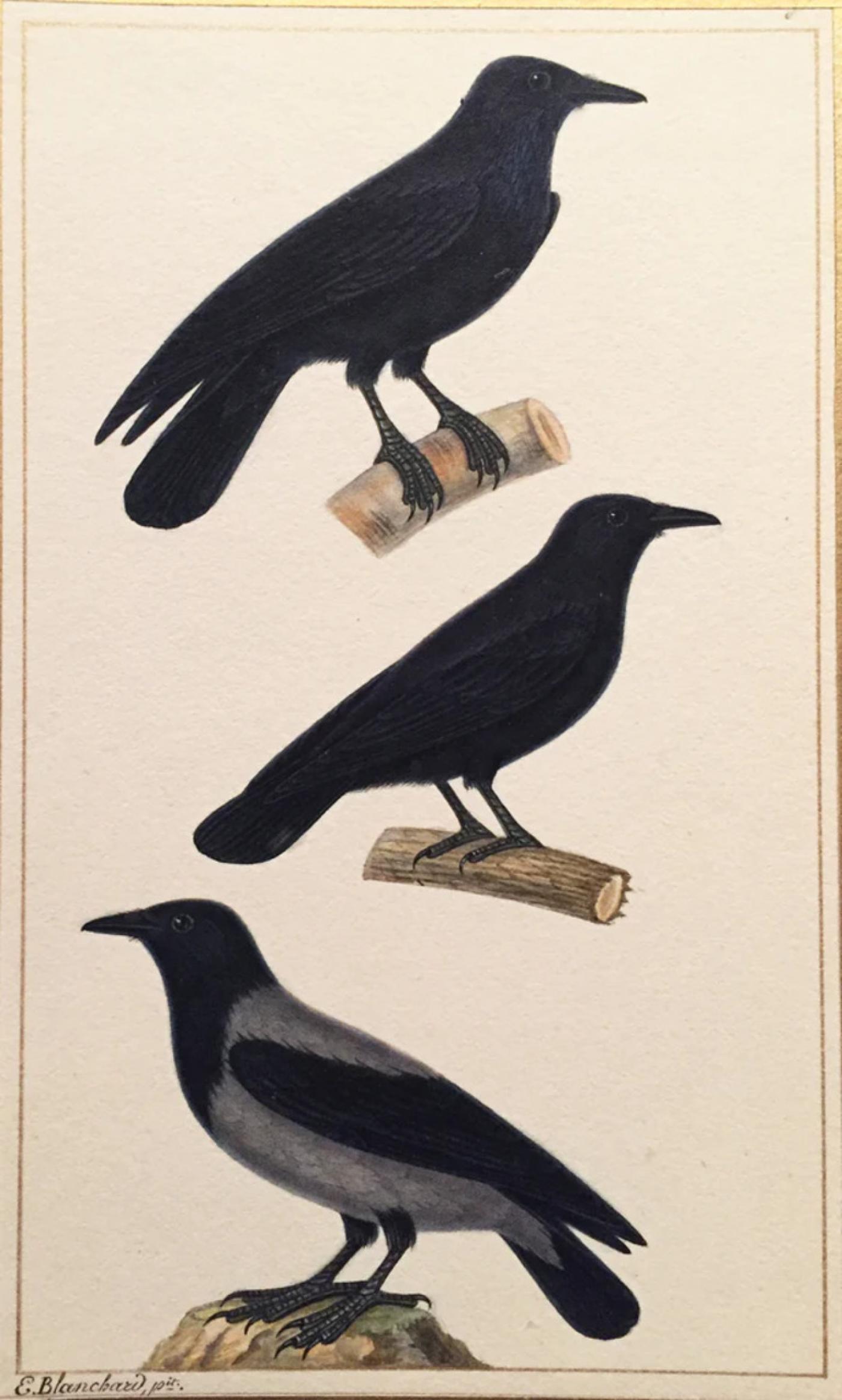
■ pour le chef-lieu du canton :

■ pour le chef-lieu d’arrondissement … euh …
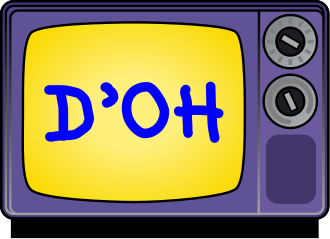
Réponse attendue chez leveto@sfr.fr